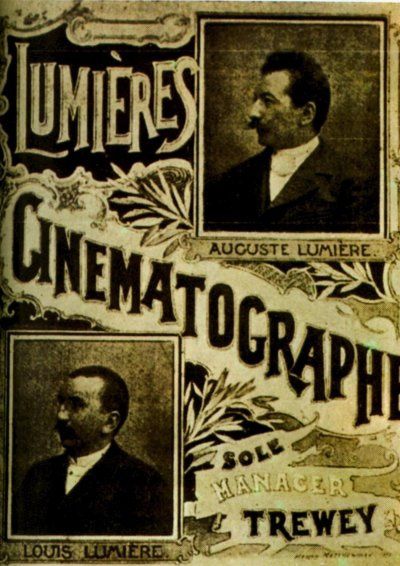Alors que Munich sort au cinéma, la guerre des mondes est loccasion de redécouvrir la passion de Steven Spielberg pour la science-fiction et le sacré dans le cinéma.
De microscopiques bactéries font louverture du générique. Environ deux heures après, la guerre des mondes sachève par un gros plan de bourgeon verdoyant sur fond dapocalypse. Pas de doute, malgré la noirceur de son film, Spielberg croit en lhomme et en la vie. Il faut tout le franchissement du film pour lapprécier, lutte éprouvante, sans aucune minute de répit ! A ce titre la violence du film (qui la vu interdire au moins de 12 ans) peut interroger mais elle est justifiée. Spielberg veut montrer que, même au cur de la pire des situations, lespérance est toujours possible.
Le film présente une traversée violente, tourmentée et même apocalyptique de lhumanité. (Les effets spéciaux hyper-réalistes expliquent aussi laspect impressionnant de limage pour le jeune public). Les extra-terrestres envahissent la terre. Ils veulent rayer de la carte le genre humain. Le vulgaire scénario dextra-terrestre nest quun prétexte pour Spielberg dont on connaît lattachement pour les films de science-fiction (Rencontre du 3ème type, ET, Minority report, AI etc ) : le réalisateur sattache surtout à parler, de manière universelle, du mal et de la nature profonde de lhomme. Il existe au cur de notre humanité un mal extérieur à nous : linvasion des aliens, comme chez Ridley Scott, symbolise surtout celle de lAlien cest-à-dire de lEtranger qui attaque la nature humaine. Les éléments se déchaînent tout au long du film, la fin du monde approche. Sous la terre, dans le ciel, par le feu et leau, lhomme est menacé par cette nature dhabitude bienfaitrice. Cette guerre des mondes incarne les attentats du 11 septembre (Le plan du caméscope par terre qui continue de filmer pendant lattaque de la ville sort tout droit des images dactualités de New York lors de lattentat). Mais elle symbolise tout autant la peur de la fin du monde, lomniprésence de la science, les catastrophes naturelles Autant de fantasmes qui actuellement terrorisent les Américains. Spielberg va encore plus loin, de manière plus personnelle, en faisant de cette destruction extraterrestre le mythe même de la violence totalitariste et fasciste. La liste de Schindler hante le film: Spielberg ne cesse dexorciser lholocauste. La guerre des mondes ne se contente pas de faire ressurgir nos peurs contemporaines par le biais du genre film de catastrophe. Il parvient en même temps à montrer le mal intérieur à lhomme. Face à des situations extrêmes, lêtre humain révèle en lui la violence, lanimalité et le meurtre. La guerre fait resurgir les démons (Il faut sauver le soldat Rian). Lhomme menacé devient menaçant.

Pour mettre en image cette allégorie du mal, le réalisateur utilise une caméra aérienne, mouvante, tournoyante, utilisant de nombreux travellings comme pour mieux exprimer luniversel du propos : lêtre humain est dépassé ; tout se déroule littéralement au dessus de lui, il est assailli de toutes parts par des forces qui le dépassent. Une vision de lhomme soumis, écrasé, étouffé par le mal, exprimée par lenfermement et claustrophobie auxquelles les personnages sont forcés. Lillustration la meilleure en est certainement la scène où le père et sa fille se sont réfugiés dans une cave avec un fou de guerre. Tout à coup une sorte de tuyau serpenté électronique surmonté dun grand il simmisce dans la cave pour vérifier sil ny a plus de trace humaine après le désastre. Tel linsidieux serpent il scrute lespace, à la recherche de sa proie. Tout est dit de manière allégorique: lil du serpent ne laisse pas lhomme innocent, il constitue une menace constante pour lhumanité. Pour survivre et protégé sa petite fille, le père joué par Tom Cruise devra même éliminer le troisième personnage enfermé avec eux. LEtranger passe alors de lextraterrestre à lhomme lui-même, le semblable. Une image du combat contre le mal, extérieur et intérieur à lhomme, comme il y en a beaucoup dans ce film.
Le réalisateur a pu donner aussi une dimension universelle à son film en le parsemant dimages poétiques atemporelles. Des vêtements pleuvent du ciel, des cendres volent dans les airs, des corps flottent dans le courant du fleuve, un paysage de rue dévasté et nous voici dans des images dactualité sur la guerre A ces moments précis, comme une respiration, le temps du récit est suspendu, le film prend des allures de mémorial.

Au sein du désastre apocalyptique, le cur du film se situe dans le traitement que fait Spielberg de la famille (AI). Linvasion du mal se vit également à petite échelle au travers de lhistoire dune famille éclatée, dun père qui veut retrouver la confiance de ses enfants. Ici le metteur en scène montrera que même si lhomme est capable de la pus grande barbarie, il est aussi capable dun amour extrême et dun instinct de survie exemplaire. Cest ce que va vivre le papa de cette histoire joué par Tom Cruise qui va sauver de la fin des temps le foyer familial et savérer être un père qui fait réellement don de sa vie. Malgré une fin trop bâclée (le défaut de Spielberg ?), le message est clair : pour Spielberg lavenir de lhumanité réside dans la famille et le perpétuel renouvellement de la vie, cycle naturel et biologique.
Voir aussi l'article sur Minority Report dans Mes Films